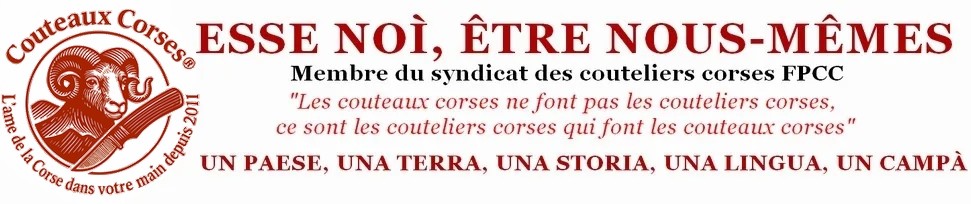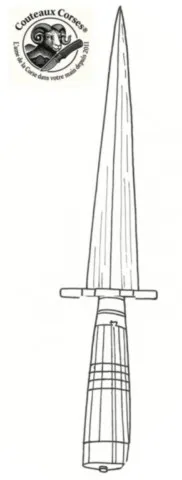Le stylet corse et son histoire
Et le stylet corse alors ?
Le stylet, si souvent mis en scène dans la littérature du XIXe siècle comme symbole de vengeance et de violence, apparaît notamment dans La Vendetta d’Honoré de Balzac (1830), Colomba de Prosper Mérimée (publiée en 1840 dans la Revue des deux Mondes puis en volume en 1841), ou encore Une vendetta de Guy de Maupassant (1884). Dans ces récits, il est présenté comme l’arme emblématique de la vendetta corse, porteur de disgrâce et d’honneur bafoué.
Pourtant, à l’origine, le stylet n’est rien d’autre qu’une dague de chasse, forgée d’une seule pièce, destinée à achever le sanglier ou le cerf insulaire. Il s’agissait d’un outil fonctionnel et efficace, bien loin de l’image dramatique que la fiction lui a donnée.
Par la suite, le stylet devient l’arme réglementaire du soldat corse, avant d’être adopté, au tournant des années 1800, comme arme de défense personnelle, accessible à tous. Vers 1900, il prend une dimension plus folklorique : on le porte volontiers en s’habillant « à la corse » ou pour imiter les figures mythifiées des bandits d’honneur.
Il est important de noter qu’il existe en Corse deux types distincts de stylets :
Le stylet à la génoise, à simple tranchant,
Et le stylet corse, à double tranchant, qui semble être d’usage plus ancien sur l’île.
Ainsi, bien avant d’être un symbole littéraire ou folklorique, le stylet était un outil de chasse, un objet fonctionnel ancré dans le quotidien insulaire.
Le stylet corse une histoire très romancée
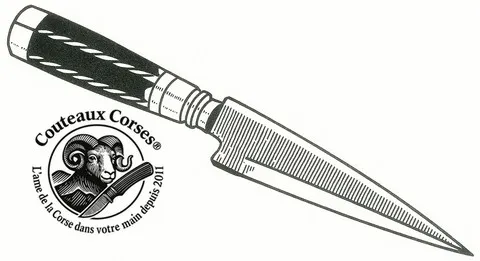
Il est important de rappeler, avant toute chose, que le stylet — qu’il soit corse ou non — est une arme d’estoc, destinée à tuer plutôt qu’à découper. En Corse, avant le XVIe siècle, le stylet n’était qu’un outil de chasse, forgé d’une seule pièce, utilisé pour abattre le sanglier ou le cerf insulaire.
C’est au début du XVIe siècle qu’il apparaît dans sa forme actuelle, aussi bien dans sa version dite « à la corse » que « à la génoise ». Le premier, à double tranchant, se distingue du second, à simple tranchant — même si, dans les deux cas, l’expression « tranchant » est en réalité impropre, l’usage premier restant la perforation, non la coupe.
La lame, forgée selon un procédé similaire à celui des clous de charpente à quatre faces, présente une section médiane sur laquelle se dessinent deux biseaux ou, dans d’autres cas, une pente unique sur chaque flanc formant un angle d’environ 30°. Le reste — garde, soie, manche — varie en taille et en style selon l’inspiration ou la "patte" de chaque forgeron.
Historiquement, le stylet est l’arme du fantassin corse, qu’il soit mercenaire ou soldat régulier. Il lui était attribué comme partie intégrante de son équipement. Initialement à double tranchant, il évoluera vers la forme « à la génoise » au cours des conflits contre Gênes, puis contre la France. Par la suite, le stylet deviendra l’arme de défense individuelle par excellence, portée au quotidien par les hommes comme par les femmes. Dans les périodes troubles que la Corse a traversées, il était considéré comme un véritable compagnon de survie. À noter que les stylets portés par les femmes étaient généralement de plus petite taille.
Au XIXe siècle, le stylet est élevé au rang de symbole littéraire, notamment dans la littérature romantique française. Il devient l'instrument emblématique de la vendetta, porteur de malheur et de fatalité. On le retrouve dans plusieurs œuvres majeures de l’époque :
La Vendetta d’Honoré de Balzac (1830)
Colomba de Prosper Mérimée (parue en 1840 dans la Revue des Deux Mondes, puis en volume en 1841)
Les Frères corses d’Alexandre Dumas (1845)
Une vendetta de Guy de Maupassant (1884)
Il est vrai que durant les XVIIIe et XIXe siècles, le stylet fut fréquemment utilisé par les « bandits d’honneur » corses dans des rixes ou des règlements de comptes, renforçant ainsi sa réputation d’arme maudite. Qu’il ait été diabolisé à juste titre ou non, le stylet reste néanmoins une pièce de coutellerie hautement valorisée en Corse. Chaque famille en possédait au moins un, souvent transmis de génération en génération.
À la fin du XIXe et au début du XXe siècle, le stylet intègre même la tenue traditionnelle, devenant un objet d’apparat. Il se pare alors de décorations élaborées, reflet du statut social de son propriétaire — en somme, l’un des tout premiers objets « bling-bling » de la société corse.
Fait notable : c’est à partir de ce fameux stylet corse, dans sa version « à la génoise », que les couteliers de Thiers, au XIXe siècle, vont concevoir la célèbre Vendetta. Inspirés par la mode littéraire romantique, ils eurent l’idée d’en faire un couteau pliant, facile à transporter, et de le décorer de maximes vengeresses gravées en idiome corso-italien, promettant la mort à l’ennemi.
Ironie du sort : c’est à partir du plus authentique des couteaux corses qu’est né... le moins corse de tous.